|
L’ODYSSEE
DES
DIX-SEPT.
(Robert
Vananove
et
Jacques
Declercq).
Avant-propos.
Au
moment
de
son
décès,
survenu
brutalement
le
6
août
1995
à
Grandmetz
,
Robert
Vananove
avait
rédigé
une
grande
partie
de
ses
souvenirs
relatifs
à
la
période
mai-août
1940
qu’il
avait
passée,
avec
seize
autres
jeunes
de
Grandmetz,
dans
les
Centres
de
Recrutement
de
l’Armée
Belge
(C.
R.
A.
B.)
dans
le
sud
de
la
France,
et
plus
particulièrement
à
Murviel,
près
de
Béziers.
La
mort
l’a
malheureusement
empêché
de
terminer
son
récit.
Ce
sont
donc
ces
notes
que
nous
nous
proposons
de
publier
ici,
complétées
de
renseignements
généraux
tirés
de
l’ouvrage
de
Jean-Pierre
du
Ry
et
de
renseignements
plus
particuliers
qui
nous
ont
été
aimablement
communiqués
par
deux
survivants
de
cette
équipée
:
Florent
Leleux
et
Rodolphe
Colinet,
que
nous
tenons
à
remercier
tout
particulièrement
pour
leur
précieuse
collaboration.
Fils
d’Oswald
,
fermier
de
la
ferme
du
Château
à
Grandmetz,
et
d’Angèle
Fontaine,
Robert
Vananove
est
né
à
Grandmetz
le
2
octobre
1921.
Il
poursuivait
des
études
d’instituteur
lorsque
survinrent
le
10
mai
1940
et
l’invasion
de
la
Belgique
par
les
troupes
hitlériennes.
Répondant,
comme
des
milliers
d’autres
jeunes
Belges,
à
l’ordre
de
rejoindre
les
centres
de
recrutement
de
l’armée
belge,
il
devint
chef
du
cantonnement
n°
20
à
Murviel.
Rentré
en
Belgique
en
août
1940,
il
termine
l’année
suivante,
à
l’Ecole
Normale
de
Tournai,
ses
études
d’instituteur,
avant
de
rejoindre
les
rangs
des
Partisans
Armés
(services
reconnus
du
1
juin
1943
au
14
octobre
1944)
et
d’être
incorporé
à
partir
du
25
avril
1945
au
2°
Groupe
de
Contrôle
des
Transports
(GCT
II/153).
En
janvier
1945,
il
avait
épousé
à
Grandmetz
Marie-Louise
Parent,
fille
d’Henri
et
de
Lucienne
Ragaru.
Il
n’exerça
guère
le
métier
d’instituteur
mais
entreprit
des
études
de
technicien
en
constructions
civiles
avant
d’occuper
la
fonction
de
géomètre
du
cadastre
à
Leuze.
C’est
en
1955
qu’il
entra
au
Ministère
de
l’Education
Nationale
où
il
termina
sa
carrière
comme
moniteur
d’organisation.
A
son
décès,
il
était
titulaire
de
la
Croix
Civique
de
2°
classe,
de
la
Médaille
de
la
Résistance,
de
la
Médaille
Commémorative
1940-45
avec
sabres
croisés
et
de
la
Médaille
des
C.
R.
A.
B.
Le
texte
de
ses
souvenirs
est
rédigé
recto-verso
sur
des
feuilles
quadrillées
paginées
par
chapitres
dont
la
table
figure
en
début
de
texte
:
1.
Etape
de
Grandmetz
vers
Furnes-Poperinghe.
2.
Passage
en
France,
direction
Abbeville.
3.
Bombardement
d’Abbeville.
4.
Abbeville-Eu
à
pied.
5.
Eu.
Embarquement
à
bord
du
train
royal.
6.
Eu-Carcassonne.
7.
Carcassonne-Narbonne.
8.
Narbonne-Béziers
en
bus.
9.
Arrivée
à
Murviel.
10.
Le
cantonnement
n°
20.
11.
Séjour
à
17.
12.
Inscription
des
3
frères
Dewée.
13.
Départ
d’Ernest,
Henri,
Léopold,
Paul,
Léon,
Emile...
au
front.
14.
Départ
de
Florent
Leleux
vers
Mont-de-Marsan.
15.
Séjour
de
Marcel
Dupire
à
l’hôpital
de
Béziers.
16.
Retour
des
premiers
à
Grandmetz.
17.
Retour
des
autres.
18.
Que
sont-ils
devenus
cinquante
ans
après.
Nous
l’avons
dit,
tous
ces
chapitres,
faute
de
temps,
ne
furent
pas
traités.
Il
manque
les
1°,
13°,
14°,
16°,
17°
et
18°,
qui
n’ont
pas
été
écrits.
Nous
avons
donc
tenté
de
les
reconstituer
grâce
aux
souvenirs
de
Rodolphe
Colinet
et
de
Florent
Leleux,
ainsi
qu’au
livre
de
Jean-Pierre
du
Ry
Le
départ
Depuis
1937,
divers
arrêtés
royaux
avaient
mis
sur
pied
une
réserve
de
recrutement
de
l’armée
belge
et
déterminé
sa
composition
et
les
étapes
de
sa
mobilisation.
Cette
réserve
de
recrutement
avait
été
créée
afin
d’éviter
(contrairement
à
ce
qui
s’était
passé
en
14
-18)
que
des
jeunes
mobilisables
ne
restent,
en
cas
d’invasion,
bloqués
en
territoire
occupé,
devenant
par
là
non
seulement
indisponibles
pour
les
combats
ultérieurs,
mais
encore
susceptibles
d’être
déportés
et
astreints
au
travail
obligatoire
par
l’occupant.
Dès
les
premières
heures
de
l’attaque
allemande,
un
premier
appel
était
lancé
aux
jeunes
de
16
à
35
ans
vivant
à
l’est
des
lignes
de
défense
constituées
par
la
Meuse
et
le
Canal
Albert
et
au
quatrième
jour
de
l’invasion,
l’ensemble
de
la
réserve
de
recrutement
avait
reçu
l’ordre
de
repli
sur
la
France.
Convoqués
par
voie
d’affiches
et
de
presse,
les
personnes
concernées
devaient
se
rendre
par
leurs
propres
moyens
(les
transports
par
chemin
de
fer
étaient
gratuits
pour
elles)
et
munies
de
vivres
pour
quarante-huit
heures
dans
un
dépôt
de
renfort
et
d’instruction
ou
dans
un
centre
de
triage.
Les
habitants
du
Hainaut,
mis
à
part
ceux
de
Charleroi,
devaient
se
rendre
à
Poperinghe.
Le
centre
de
Poperinghe
était
commandé
par
le
colonel
Jules
Van
Houberg,
ancien
de
14-18,
aidé
de
trois
lieutenants.
C’est
pour
rejoindre
cette
localité
que,
le
12
mai
à
10
heures,
dix-sept
jeunes,
parmi
lesquels
Robert
Vananove,
prenaient
le
train
à
la
gare
de
Grandmetz.
Il
régnait
une
situation
chaotique
dans
la
petite
ville
flamande
qui
avait
recueilli
quelque
100.000
réfugiés.
Un
témoin
écrira
:
«
La
Grand-Place
était
noire
de
monde,
pleine
de
garçons
qui
criaient
à
manger,
à
manger,
à
manger
!
».
Un
autre
dira
:
«
On
aurait
pu
marcher
sur
les
têtes
».
Il
s’agit
alors
d’évacuer
vers
la
France
les
16-35
ans
de
la
réserve
de
recrutement.
Malgré
la
pagaille
qui
règne
dans
le
réseau
ferroviaire,
le
colonel
Van
Houberg
fera
embarquer
le
15
mai
1.200
hommes
dans
un
train.
Six
autres
convois
s’ébranleront
encore
de
Poperinghe
le
17,
emmenant
vers
le
sud
7.500
hommes.
Parmi
eux,
les
jeunes
de
Grandmetz.
Nous
n’avons
pas
pu
déterminer
à
quelle
date
les
hommes
de
Grandmetz
ont
quitté
la
Belgique.
Quoi
qu’il
en
soit,
ils
parvinrent
jusqu’à
Abbeville,
juste
à
temps
pour
assister
au
bombardement
de
cette
ville,
le
20
mai.
C’est
là
que
commence
le
récit
de
R.
Vananove.
|
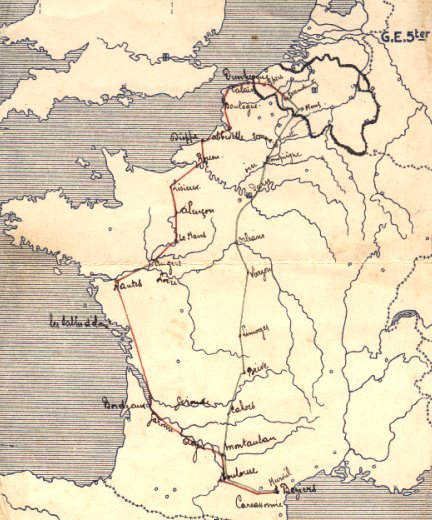
|
|
Carte
du
voyage
à
Murviel
et
du
retour,
dressée
par
Florent
Leleux.
|
  
Les
souvenirs
de
Robert
Vananove,
ou
l’Odyssée
des
Dix-sept.
Le
10
mai
1940,
le
gouvernement
ordonne
à
tous
les
hommes
âgés
de
16
à
35
ans
de
rejoindre
les
rangs
de
l’armée
et
de
se
diriger
sur
la
France.
C’est
ainsi
que
dix-sept
hommes
concernés
par
cet
ordre
se
retrouvent
sur
le
quai
de
la
gare
de
Grandmetz
le
12
mai
à
10
heures.
Ils
disent
au
revoir
qui
à
leurs
parents,
qui
à
leur
femme
ou
à
leur
fiancée
et
ainsi
commence
l’Odyssée
des
Dix-sept.
  
Le
bombardement
d’Abbeville.
Je
m’en
souviens.
Nous
étions
arrêtés
sur
la
ligne
de
chemin
de
fer
à
1
km
environ
au-delà
de
la
gare
d’Abbeville.
Cette
ligne
de
chemin
de
fer
était
largement
encaissée,
à
deux
voies
parallèles.
Nous
étions
assis
dans
un
wagon
de
marchandises
(hommes
40,
chevaux
8).
Sur
la
voie
parallèle
était
arrêté
un
autre
train
militaire,
des
Tommies.
Ils
allaient
au
front,
repousser
l’envahisseur,
pleins
d’enthousiasme
et
de
confiance.
A
peu
de
distance,
nous
voyions
les
avions
allemands
bombarder
Abbeville,
et
surtout
la
gare.
En
sortant
de
nos
wagons,
nous
apercevions
les
bombes
tomber
et
des
colonnes
de
fumée
s’élever
des
incendies
provoqués.
A
un
certain
moment,
les
Tommies
ont
sorti
leur
arsenal
de
guerre,
installé
entre
les
deux
trains
leurs
mitrailleuses
sur
pied
et
lorsque
les
Messerschmidt
sont
revenus,
ils
n’ont
pas
hésité
à
les
mitrailler.
Nous
avons
vu
un
avion
allemand
tomber
sur
la
ville
avec
une
colonne
de
fumée.
La
réaction
ne
fut
pas
longue.
Je
vois
encore
ces
machines
de
guerre
prendre
notre
ligne
de
chemin
de
fer
en
enfilade
et,
en
piqué,
à
quelques
dizaines
de
mètres,
mitrailler
nos
convois.
En
quelques
secondes,
nous
étions
hors
des
wagons
et
couchés
sous
ceux-ci,
entre
les
essieux.
Nous
avons
subi
ainsi
trois
assauts
et
les
balles
des
mitrailleuses
traversaient
le
haut
de
nos
wagons.
Le
calme
revenu,
nous
sommes
sortis
de
nos
cachettes.
Les
officiers
anglais
rassemblaient
leurs
hommes
et,
sac
au
dos,
mitrailleuse
sur
l’épaule,
les
faisaient
suivre
la
voie
de
chemin
de
fer
pour
monter
à
pied
vers
le
front.
Le
soir
venu,
nous
sommes
remontés
dans
nos
wagons
et,
toutes
ces
émotions
nous
ayant
fatigués,
nous
nous
sommes
endormis.
A
cinq
heures
du
matin,
Léopold
est
descendu
et
a
suivi
la
ligne
de
chemin
de
fer.
Une
heure
après,
il
est
revenu,
nous
a
réveillés
pour
nous
annoncer
que
nous
étions
les
seuls
êtres
vivants
sur
plusieurs
centaines
de
mètres
de
chaque
côté.
Les
convois
vides
étaient
bloqués
à
la
queue-leu-leu.
Il
fallait
prendre
une
décision.
D’abord
manger,
puis
partir.
Ce
n’était,
le
long
de
cette
voie,
que
valises
éventrées,
abandonnées
;
nous
avons
visité
le
train
militaire
abandonné
et
dans
le
dernier
wagon
de
marchandise,
nous
avons
trouvé
du
ravitaillement,
des
boîtes
de
sardines,
du
chocolat.
Je
me
souviens
que
là,
j’ai
trouvé
un
réveil,
un
baromètre,
une
paire
de
souliers
neufs
de
pointure
42,
-
je
chausse
du
37,
mais
ils
sont
les
bienvenus
-,
et
un
appareil
photographique.
Tout
ce
matériel
a
été
suspendu
à
mon
sac
à
dos.
Nous
avons
vidé
des
valises
abandonnées
et
les
avons
remplies
de
ravitaillement.
Nous
avions
emporté
au
départ
quelques
provisions
vite
épuisées,
et
à
Poperinghe,
Oger
avait
réussi
à
nous
ravitailler
en
pain
et
en
bière.
La
découverte
des
provisions
anglaises
a
suffi
à
nous
rassasier.
Je
vois
encore
ce
tonneau
de
vin
percé
par
la
mitraillade
et
tout
le
vin
rouge
couler
à
travers
du
plancher.
Une
décision
à
prendre
:
maintenant
se
mettre
en
route.
Nous
étions
précédés
par
des
évacués
qui
nous
annonçaient
des
nouvelles
peu
rassurantes
:
les
Allemands
avançaient.
Je
me
souviens
de
ce
triste
tableau
:
deux
jumeaux
d’environ
17-18
ans
avaient
été
tués
la
veille
par
le
mitraillage
des
Messerschmidt
sous
les
yeux
de
leurs
parents.
Je
vois
encore
ce
père
et
cette
mère,
prostrés
près
des
corps
de
leurs
fils,
voulant
tous
deux
mourir
sur
place,
à
côté
des
deux
cadavres
allongés
sur
le
talus.
Qui
les
aura
enterrés
?
Et
pourtant,
nous
sommes
repartis
à
pied
le
long
des
convois
pour
joindre
la
côte.
Nous
avons
suivi
pendant
des
heures
cette
ligne
de
chemin
de
fer.
Nous
sommes
arrivés
dans
une
gare
avec
de
nombreuses
voies
:
c’était
Eu.
Nous
avons
cherché
des
renseignements.
Puis
nous
avons
aperçu
une
locomotive
tirant
quelques
wagons.
Nous
sommes
parvenus,
après
des
palabres
avec
un
chef-garde
portant
une
couronne
royale
sur
son
képi,
à
lui
imposer
notre
présence.
C’était,
paraît-il,
le
train
royal
en
partance
pour
l’Espagne.
Quelques
personnes
nous
avaient
suivis.
Nous
étions
une
bonne
vingtaine
entassés
dans
un
demi
fourgon
qui
devait
servir
au
transport
de
marchandises,
l’autre
demi
étant
le
logement
du
garde
du
convoi.
Après
quelques
heures,
nous
avons
appris
que
ce
convoi,
composé
au
maximum
de
trois
voitures
et
de
ce
fameux
fourgon
de
queue,
se
rendait
en
Espagne
;
tous
ensemble,
nous
avons
décidé
de
nous
y
laisser
conduire.
Au
fil
des
heures,
nous
sommes
arrivés
à
Carcassonne.
Quelques
copains
sont
partis
aux
renseignements.
La
gare
était
pleine
de
gens
du
nord
qu’on
essayait
de
caser
dans
les
environs.
Devant
cette
pagaille,
nous
avons
regagné
notre
fourgon,
nous
y
sommes
dissimulés,
portes
fermées,
et
avons
attendu.
Puis
le
train
est
reparti
et
à
l’arrêt
suivant,
nous
étions
à
Narbonne.
Mais
là,
notre
présence
devait
être
signalée
car
nos
portes
se
sont
ouvertes
et
la
gendarmerie
française
nous
a
poliment
priés
de
vider
les
lieux
et
de
rejoindre
les
évacués
à
la
gare
où
nous
avons
reçu
à
boire.
Toujours
groupés
à
17,
on
nous
a
embarqués
dans
un
bus
et
c’est
comme
cela
que
nous
sommes
arrivés
sur
la
place
de
Murviel
où
nous
avaient
devancé
énormément
de
jeunes,
presque
tous
des
Flamands.
Nous
avons
circulé
dans
les
groupes
et
avons
appris
qu’il
y
avait
un
commandant
de
place
qui
était
chargé
de
répartir
les
hommes
dans
les
cantonnements.
Je
me
suis
présenté
au
bureau
de
ce
commandant.
J’ai
expliqué
que
nous
étions
dix-sept
jeunes
du
même
village,
que
nous
avions
fait
tout
le
chemin
depuis
la
Belgique
ensemble
et
que,
dans
la
mesure
du
possible,
nous
serions
heureux
de
rester
ensemble.
Cette
possibilité
nous
fut
accordée
et
on
nous
attribua
la
grange
de
Célestin
Griffe,
le
cantonnement
n°
20.
Le
cantonnement
n°
20.
Une
très
grosse
bâtisse
;
au
rez-de-chaussée,
une
grange
avec
porte
cochère
et
une
petite
porte,
toutes
deux
encadrées
de
pierres
de
France
avec
clé
de
voûte
;
à
côté,
une
écurie
avec
un
vieux
cheval
et,
à
l’arrière
de
celle-ci,
un
escalier
donnant
vers
l’extérieur
et
accédant
à
une
cour,
la
cour
du
bistrot.
Au
premier
étage,
l’appartement
de
Célestin
Griffe,
propriétaire
de
tout
le
bloc,
déjà
âgé
de
80
ans
à
cette
époque.
Au
second
étage,
l’appartement
de
son
beau-fils,
de
sa
fille
et
du
petit
Roger,
alors
âgé
de
13-14
ans.
Le
jeune
ménage
exploitait
le
café
attenant.
Cette
partie
a
été
vendue
et
transformée.
C’est
maintenant
devenu
le
bureau
des
postes.
Ces
appartements
étaient
accessibles
par
un
escalier
extérieur
adossé
au
pignon
de
l’écurie
et
donnant
également
sur
la
terrasse
du
café.
Que
sont-ils
devenus
?
C’est
là
que
Léopold
a
baptisé
notre
grange
«
Aux
Privés
d’Amour
».
Notre
installation.
Elle
fut
très
rapide.
On
a
plus
ou
moins
nettoyé
la
grange
au
sol
en
terre
battue
et
enlevé
les
toiles
d’araignées.
Ce
local
fut
divisé
en
deux
parties.
Le
coin
à
dormir
était
dans
le
fond
du
local,
où
la
paille
que
l’on
nous
avait
distribuée
était
étendue
sur
deux
rangées,
une
de
huit
et
une
de
neuf
personnes.
La
paille
était
retenue
par
une
planche
posée
à
champ.
La
deuxième
partie
était
le
coin
à
manger.
En
entrant
dans
la
grange,
à
droite
derrière
cette
demi
grand-porte,
il
y
avait
une
ancienne
cheminée
avec
une
cuve
en
fonte
qui
servait
à
cuire
les
aliments
des
animaux.
Inutilisable.
Après
maints
lavages,
cette
cuve
servait
de
garde-manger
pour
le
pain.
Nous
avons
récupéré
une
table
à
tréteaux
et
deux
bancs
pour
y
manger.
Après
quelques
temps,
les
camarades
ont
installé
des
étagères
pour
le
rangement.
Nous
nous
installions...
Le
surlendemain
de
notre
arrivée,
je
fus
appelé
au
bureau
du
commandant.
J’étais
alors
le
seul
connu
et
je
fus
désigné
comme
chef
du
cantonnement,
responsable
de
l’ordre,
du
ravitaillement
et
de
tous
les
rapports
entre
les
copains
et
le
commandement.
La
première
remarque
que
l’on
me
fit
fut
que
la
grange
devait
abriter
vingt
personnes
et
que
nous
n’y
étions
que
dix-sept.
L’on
me
signifia
que
je
devais
compléter
l’effectif,
soit
en
y
inscrivant
trois
autres
personnes,
soit
qu’on
nous
les
imposerait.
Par
une
chance
inouïe,
nous
avons
rencontré
les
trois
frères
Dewez
qui,
bien
munis
d’argent,
avaient
trouvé
place
à
l’hôtel,
mais
devaient
absolument
être
inscrits
dans
un
cantonnement
et
y
être
recensés.
Nous
les
avons
acceptés
dans
notre
campement,
mais
ne
les
voyions
que
très
rarement.
Nous
avions
donc
notre
compte
de
personnes.
Autre
avantage
:
nous
bénéficiions
de
trois
rations
supplémentaires
:
pain,
repas
de
midi
etc...
La
vie
au
camp.
Des
cuisines
militaires
étaient
installées
au
bas
de
la
rue
et
tous
les
jours,
c’était
la
cohue
et
la
queue
pour
recevoir
la
ration
du
dîner
et
le
pain
pour
le
reste
de
la
journée.
Après
un
peu
d’organisation
et
de
connaissance,
à
tour
de
rôle,
avec
seaux
et
marmites,
deux
ou
trois
hommes
faisaient
la
file
et
ramenaient
les
parts
de
tous
au
cantonnement.
Chacun
mangeait
selon
sa
faim
et
le
pain
supplémentaire
était
conservé
dans
la
cuve
en
fonte.
Nous
avions
enduré
à
l’aller
mais
nous
prévoyions
déjà
le
retour.
Peu
à
peu
la
vie
s’organisa.
Chaque
jour
à
10
heures,
il
y
avait
appel
au
bureau
du
commandant
pour
tous
les
chefs
de
cantonnement.
On
faisait
rapport
sur
la
vie
du
groupe,
exprimait
les
désirs
des
uns,
les
remarques
des
autres
;
on
y
recevait
les
instructions
et
les
devoirs
à
observer.
On
nous
imposa
le
couvre-feu.
Chaque
semaine,
il
fallait
désigner
un
homme
pour
faire
le
ramassage
des
ordures
avec
un
camion.
Après
quelques
jours,
Ernest,
Henri
Vandenhende,
Léopold,
Fernand
et
quelques
autres
proposèrent
leurs
services
à
la
ferme
voisine.
Ils
purent
ainsi
s’occuper,
faucher
la
luzerne
ou
l’avoine,
sulfater
les
vignes
et
effectuer
divers
travaux
aux
cultures
locales.
Une
reconnaissance
s’était
établie
entre
ces
hommes
et
la
fermière
et
bien
souvent,
ils
ramenaient
au
cantonnement
un
seau
de
vin
ou
d’autres
ravitaillements.
Le
vin,
nous
en
avions
trop,
alors
on
le
transvasait
dans
des
bouteilles
et
après
quelques
jours,
nous
avions
un
vin
aigre.
Il
nous
servait
à
assaisonner
notre
salade.
Georges
allait
tous
les
jours
à
la
pêche
dans
l’Orb
à
Réals.
Quelquefois,
on
mangeait
du
poisson.
Le
vieux
Célestin
nous
avait
pris
en
amitié,
Georges
et
moi.
Il
se
levait
très
tôt
et
allait
se
promener
dans
les
vignes.
Un
jour,
il
avait
cueilli
un
seau
de
petits
escargots.
Il
nous
proposa
de
les
cuire
et
les
préparer
à
sa
façon.
Nous
acceptâmes
et
c’est
ainsi
que
,
pour
la
première
fois,
nous
avons
mangé
des
escargots.
Pour
ce
que
je
m’en
souvienne,
il
les
fit
dégorger
avec
du
sel,
puis
cuire
;
puis
il
les
extraya
de
leur
coquille
et
prépara
une
sauce
à
l’ail
dans
une
casserole
où
il
termina
la
cuisson
des
escargots.
Depuis
ce
jour,
j’adore
les
escargots.
Je
vous
ai
dit
que
le
cantonnement
était
pour
vingt
hommes,
que
nous
y
étions
dix-sept
de
Grandmetz
et
que
pour
compléter
le
nombre,
nous
avions
hébergé
les
trois
frères
Dewez.
Ces
pauvres
avaient
un
compte
en
banque
à
Bordeaux
et
quand
le
besoin
s’en
faisait
sentir,
on
transférait
des
fonds
à
Béziers
où
ils
allaient
se
réapprovisionner.
Un
jour,
ils
avaient
décidé
de
rentrer
en
Belgique,
et
pour
fêter
l’événement,
ils
ont
payé
à
boire
à
tous
les
présents.
Tant
et
si
bien
que
le
bistrot
a
été
fermé
à
la
clientèle
habituelle
et
l’occupation
du
local
réservée
à
notre
groupe.
Qu’est-ce
qu’on
y
vida
!
Toutes
les
bouteilles
alignées
sur
le
comptoir,
sur
une
espèce
de
verrier,
y
passèrent
(Pernod,
Gentiane,
Anisette,
Marie
Brisard),
et
c’est
là
qu’arrive
mon
histoire.
Le
Ricard
se
buvait
dans
des
verres
à
bière.
Marcel
Dupire,
malgré
les
avertissements,
s’en
pourléchait
les
babines
et
aux
nombreuses
mises
en
garde,
il
répondait
:
«
Du
pareil,
j’é
buvrie
enn’tonne
».
(De
cela,
j’en
boirais
un
tonneau).
Jusqu’au
moment
où
on
dut
ramener
Marcel
sur
la
paille
au
cantonnement.
Je
dois
vous
signaler
que
le
repas
de
midi
était
constitué
principalement
de
haricots
blancs.
Mais
la
nuit,
le
Ricard
ne
faisant
pas
bon
ménage
avec
les
haricots,
le
pauvre
voulut
savoir
s’il
avait
eu
son
compte
et
tout
le
dîner,
les
apéros,
les
pousse-café
firent
le
voyage
en
sens
inverse.
Quelqu’un
vola
à
son
secours
;
son
seul
et
grand
copain
était
Emile
Fontaine,
qui
lui
tendit
un
seau
où
il
pouvait
se
soulager.
Toute
la
chambrée
était
sur
pied
et
suivait
anxieusement
l’évolution
de
la
situation.
Lorsque
le
seau
fut
à
moitié
rempli,
quelqu’un
situé
au
deuxième
rang,
par
inadvertance
ou
par
mégarde,
poussa
un
petit
coup
et
dans
la
panique,
le
seau
se
renversa
et
Marcel
reçut
tout
son
contenu
sur
le
corps.
Le
lendemain,
il
était
raide,
il
était
dégoûtant
et
il
puait.
On
put
aussi,
à
la
place
qu’il
occupait,
enlever
toute
la
paille
:
c’était
du
fumier.
Cet
incident
se
passa
très
vite,
et
quelques
jours
plus
tard,
c’était
oublié.
Marcel
est
mort.
Je
vous
ai
dit
que
chaque
cantonnement
devait
déléguer
un
homme
pour
le
ramassage
des
immondices.
C’était
au
tour
de
Marcel.
Nous
le
voyons
encore
assis
sur
les
ridelles
du
camion,
en
train
de
faire
le
singe.
Voilà-t’il
pas
que
dans
un
virage
pris
trop
sèchement
par
le
chauffeur,
notre
Marcel
est
déséquilibré
et
tombe
sur
la
route
de
toute
la
hauteur
du
camion.
Assommé,
blessé,
on
appelle
une
ambulance
de
l’hôpital
de
Béziers,
et
voilà
notre
Marcel
parti.
Le
lendemain,
le
bruit
court
à
Murviel
que
le
jeune
homme
emmené
la
veille
à
l’hôpital
est
décédé.
Consternation
dans
notre
camp.
Nous
décidons,
Florent
et
moi,
de
nous
rendre
à
la
clinique
pour
de
plus
amples
renseignements.
Là,
on
nous
confirme
que
le
jeune
homme
de
Murviel
emmené
la
veille
à
l’hôpital
est
décédé.
Nous
rentrons
donc
apprendre
à
nos
camarades
la
triste
nouvelle.
J’ai
oublié
de
vous
dire
qu’au
départ
de
Grandmetz,
nous
avions
tous
des
provisions
vite
épuisées,
mais
que
Marcel,
par
souci
de
prévoyance,
avait
emporté
dans
son
sac
à
dos
un
jambon
de
4
à
5
kgs
et
un
pot
de
beurre
de
quelques
kilos.
Avec
le
pain
que
nous
recevions,
c’était
son
repas
du
soir.
Le
voilà
décédé,
et
les
provisions
n’étaient
toujours
pas
épuisées.
Après
examen
des
objets
personnels
restés
au
cantonnement,
la
décision
fut
prise
de
partager
les
victuailles
et
chacun
hérita
d’un
peu
de
jambon
et
d’une
bonne
couche
de
beurre
sur
sa
tartine.
Plutôt
que
du
gaspillage...
Enfin,
la
vie
continue
et
plus
personne
ne
pense
au
jambon,
et
de
moins
en
moins
à
Marcel.
Voilà-t’il
pas
qu’une
dizaine
de
jours
après
tous
ces
événements,
le
bus
venant
de
Bézier
et
passant
par
Murviel
débarque
un
fringant
jeune
homme
tout
gaillard..."
Ainsi
se
termine
le
texte
que
R.
Vananove
nous
a
laissé.
Le
fringant
jeune
homme
tout
gaillard
qui
débarquait
du
bus
de
Béziers
n’était
évidemment
autre
que
Marcel
Dupire,
bien
vivant
et
en
pleine
forme,
et
qui
n’en
voulut
pas
trop
à
ses
camarades
d’avoir
ainsi
fait
le
partage
de
ses
victuailles.
La
fin
du
séjour.
Une
autre
épreuve
attendait
encore
la
bande
des
17
:
celle
de
l’éclatement
de
leur
groupe.
Ce
fut
d’abord
Florent
Leleux
qui,
comme
étudiant
en
pharmacie,
dut
quitter
Murviel
pour
rejoindre
le
service
de
santé
de
l’armée
belge
aux
Sables-d’Olonnes.
Parti
le
mercredi
18
juin
par
Mont-de-Marsan,
il
ne
put
cependant
dépasser
Bordeaux
à
cause
de
l’avance
allemande
et
revint
à
Murviel.
Plus
tragique
aurait
pu
être
le
départ,
début
juin,
de
neuf
hommes
réquisitionnés
et
envoyés
vers
le
front.
En
effet,
sous
la
pression
du
gouvernement
français,
le
gouvernement
Pierlot
allait
mettre
à
la
disposition
de
l’armée
française
des
compagnies
de
travailleurs
âgés
en
principe
de
plus
de
19
ans.
Destinées
à
l’arrière
du
front
pour
aider
le
génie
français
à
édifier
des
lignes
de
défense,
ces
compagnies
vont
se
retrouver
brutalement,
sans
aucune
préparation,
en
première
ligne,
face
à
l’avance
fulgurante
des
troupes
allemandes.
A
Murviel,
le
1
juin
à
19
heures,
les
lois
militaires
avaient
été
lues
à
tous
les
C.
R.
A.
B.
leur
indiquant
par
là
leur
statut
de
militaire
(statut
qui
leur
sera
refusé
par
ailleurs
après
la
guerre...).
Parmi
les
jeunes
de
Grandmetz
incorporés
dans
ces
compagnies,
citons
Léon
Deparis,
Léopold
Papin,
Ernest
Duhain,
Henri
Vandenhende,
Paul
Cambier,
Emile
Fontaine,
Marcel
Leclercq
et
Jean
Delehaye.
Tous
eurent
la
chance
de
rentrer
sains
et
saufs
à
Grandmetz,
avant
même
leurs
compagnons
restés
à
Murviel.
Quant
à
ceux-ci,
ils
passaient
leur
temps
comme
ils
pouvaient,
aidant
les
habitants
de
ce
pauvre
pays
aux
travaux
agricoles
et
ménagers,
ce
qui
leur
permettait
d’améliorer
l’ordinaire
de
la
cantine
dont
les
cuistots,
tous
nordistes,
semblaient
mieux
remplir
les
gamelles
des
Flamands
que
celles
des
Wallons.
A
partir
du
15
juillet,
ils
toucheront
une
solde
de
trois
francs
par
jour.
Grâce
à
la
faveur
dont
il
jouit,
vu
sa
jeunesse,
auprès
de
la
boutiquière
du
coin,
R.
Colinet
peut
fournir
à
G.
Bille
du
matériel
de
pêche
dont
il
se
servira
pour
aller
pêcher
dans
l’Orb.
Ce
torrent
poussera,
par
ces
chaleurs
peu
habituelles
pour
des
Belges,
ces
jeunes
à
la
baignade
qui,
pourtant,
n’était
pas
sans
danger
dans
ses
eaux
glaciales.
R.
Colinet
se
souvient
de
la
noyade
de
trois
C.
R.
A.
B.
Le
9
juin,
deux
fils
uniques
de
17
et
18
ans,
l’un
de
Meslin-l’Evêque,
l’autre
de
Jumet,
morts
par
noyade,
seront
enterrés
à
Murviel.
.
Sont-ce
ces
deux
décès
que
J.
P.
du
Ry
cite
à
Murviel
le
5
juin?
Fin
juillet,
des
entrevues
ont
lieu
entre
le
colonel
Goethals
et
le
général
von
Falkenhausen
en
vue
d’organiser
le
rapatriement
rapide
des
C.
R.
A.
B.
Cepandant,
dès
avant
la
mise
sur
pied
de
cette
organisation,
des
initiatives
privées
s’étaient
vues
couronner
de
succès.
Ainsi,
le
23
juillet,
deux
camions
partis
de
Merelbeke
(Flandre
Orientale)
arrivent
à
Murviel
et
repartent
aussitôt
avec
les
Merelbekois
du
cantonnement.
Le
jeudi
1
août,
les
quelque
200
hommes
restant
encore
à
Murviel,
parmi
lesquels,
sans
doute,
nos
Grandmetois,
sont
informés
qu’ils
doivent
être
le
samedi
3
à
22
heures
à
la
gare
de
Magalas.
«
Cette
joyeuse
perspective
efface
toutes
les
tristesses.
La
joie
éclate
dans
la
soirée
qui
précède
la
levée
du
cantonnement.
Des
granges
et
d’autres
logements,
les
futurs
rapatriés
se
dirigent
vers
la
place
du
marché.
On
crie,
on
se
congratule,
on
chante.
La
nuit
entière
est
consacrée
à
de
sympathiques
débordements.
Ceux
qui
veulent
quand
même
dormir
en
sont
pour
leurs
frais
:
la
bruyante
euphorie
troublera
leur
repos
jusqu’au
petit
matin
».
Alors
s’effectue
le
retour
tant
attendu
:
en
wagons
à
bestiaux,
sans
en
sortir,
ravitaillés
parcimonieusement
par
la
Croix-Rouge,
ils
remontent
vers
le
nord
:
Toulouse,
Montauban,
Cahors,
Brive,
Limoges,
Vierzon,
où
l’on
passe
la
ligne
de
démarcation,
Orléans,
l’est
de
Paris,
Compiègne,
Saint-Quentin,
Mons;
et
de
Mons,
par
Leuze
jusqu’à
Ath.
Et
partout,
sur
les
quais
des
gares
de
la
zone
occupée,
les
uniformes
allemands...
Passant
à
Mons
le
vendredi
9
août
vers
13
heures,
le
train
déposera
nos
hommes
à
Grandmetz
vers
18
heures.
Un
seul
n’ira
pas
jusqu’à
Ath
:
R.
Colinet
sautera
du
train
qui
ralentissait
à
Ligne
et
sera
ainsi
le
premier
rentré
à
Grandmetz
à
goûter
aux
joies
des
retrouvailles.
La
date
exacte
de
ce
retour
reste
inconnue
;
mais
les
états
de
service
de
R.
Vananove
portent,
pour
la
reconnaissance
du
statut
C.
R.
A.
B.
celle
du
6
août
1940.
Epilogue.
Rentrés
dans
un
pays
vaincu,
occupé,
dévasté,
nos
jeunes
gens
découvraient
une
vie
nouvelle
qui
s’ouvrait
devant
eux.
Ce
qu’il
advint
de
R.
Vananove,
nous
l’avons
signalé
plus
haut.
Rodolphe
Colinet
établit
un
commerce
de
charbon
à
Chapelle-à-Wattines.
Léopold
Papin,
qui
aurait
dû
être
incorporé
au
11°
d’artillerie
à
Tournai
avec
la
classe
1938
mais
ne
l’avait
pas
été
à
cause
des
circonstances,
fut
réquisitionné
du
30/11/1942
au
8/3/1943
pour
le
travail
obligatoire
en
Allemagne
;
il
sera
ensuite
chauffeur
de
camion.
Henri
Vandenhende
deviendra
cantonnier
communal
;
Emile
Fontaine,
cultivateur,
de
même
que
Marcel
Dupire
et
Léon
Deparis
qui,
appelé
avec
la
classe
41
grossira
les
rangs
du
45°
fusiliers
à
Audenarde
et
sera
plus
tard
conseiller
communal
et
échevin
de
Grandmetz.
Marcel
Leclercq
sera
ouvrier
à
la
S.
N.
C.
B.
alors
qu’Edouard
Moreau
y
sera
ingénieur.
Jean
Delehaye
sera
cafetier
;
Ernest
Duhain,
plafonneur,
mourra
accidentellement
à
Melles.
Florent
Leleux
sera
pharmacien
à
Tournai
;
Paul
Cambier,
représentant
en
textile
et
Georges
Bille,
directeur
à
Sobelta.
Les
survivants
de
cette
équipée
ne
manquèrent
pas,
lorsqu’enfin
l’administration
leur
reconnut,
près
de
cinquante
ans
après,
le
droit
à
la
reconnaissance
nationale,
de
réclamer
la
carte
attestant
de
leur
qualité
de
C.
R.
A.
B.
et
du
droit
à
porter
la
distnction
honorifique
y
afférente.
|
Les
Crabs
de
Grandmetz
devant
la
grange
de
Célestin
Griffe.
|
|

|
|
De
gauche
à
droite:
Accroupis:
Rodolphe
Colinet,
Léopold
Papin,
Henri
Vandenhende,
Oger
Declèves,
Emile
Fontaine;
Debout:
Marcel
Leclercq,
Edouard
Moreau,
Jean
Delehaye,
Marcel
Dupire,
Léon
Deparis,
Ernest
Duhain,
,
Florent
Leleux,
Henri
Duhain,
Fernand
Gérard,
Paul
Cambier,
Robert
Vananove,
devant
Georges
Bille.
|
|

|
|
La
grange
de
Célestin
Griffe,
40
ans
après...
|
  
|